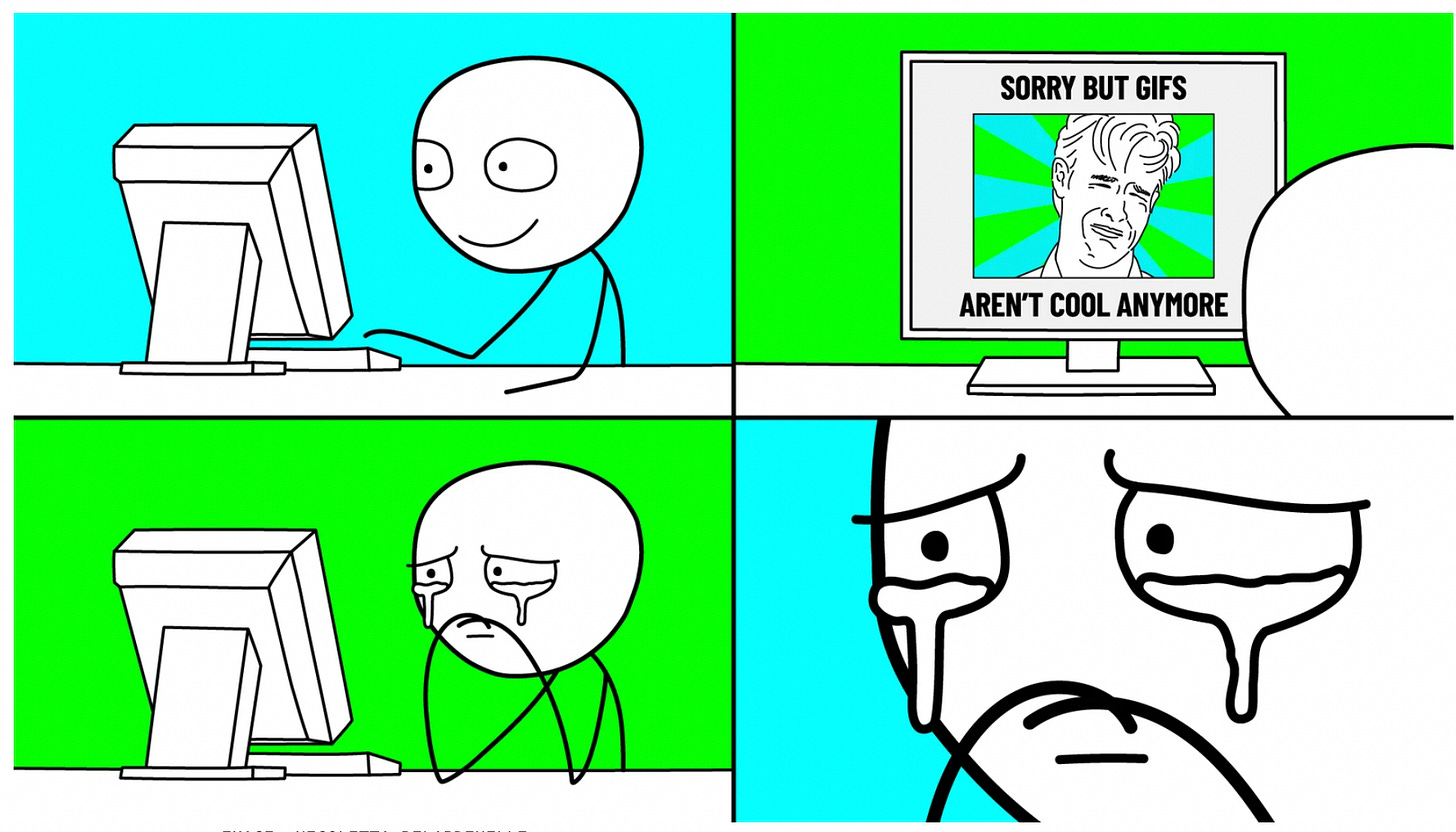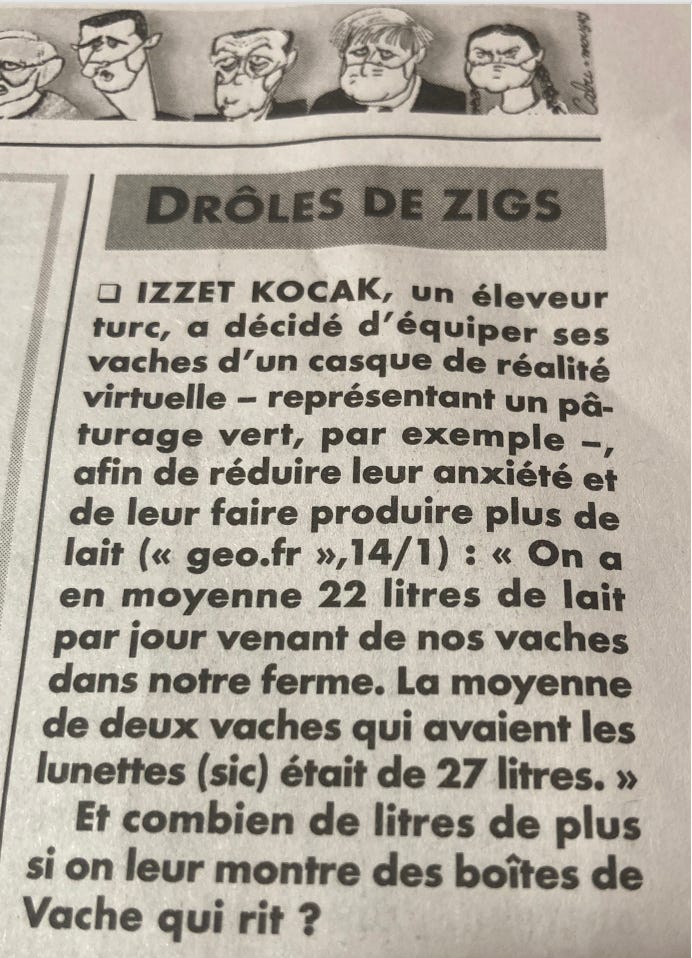Fractures alimentaires, “génération McDo”, baromètre de confiance des médias, “business de la flemme”, les marques en campagne présidentielle, emoji-nation et “le beau au prix du laid” : elles ont fait (ou pas) l’actualité, voilà la veille des idées du mois de février 2022.
Temps de lecture estimé : 15 minutes
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION

“Le steak-frites est passé à droite”
C’est la réflexion que livre Jean-Laurent Cassely dans un excellent entretien au Monde, au cours duquel il constate que “le débat politique s’est déporté vers des sujets culturels au détriment de sujets socio-économiques”:
“D’une certaine manière, le steak et les frites décryptés par Roland Barthes dans ses Mythologies sont eux aussi passés à droite. Avec la musculation, la barbe ou certaines marques vestimentaires, la viande rouge fait partie des nouveaux marqueurs lifestyle des identitaires, associée à une idée de santé, de force, de virilité. On a constaté le même mouvement aux Etats-Unis au travers de l’apologie du barbecue. A l’époque de Donald Trump, la viande grillée était présentée comme la nourriture de la working class américaine alors que l’avocado toast, c’était l’aliment des bobos efféminés qui votaient démocrate”
Comment expliquer cette politisation de l’alimentation ?
“L’alimentation, mais aussi la voiture, la maison individuelle, l’avion, tous les marqueurs des modes de vie hérités de l’imaginaire des « trente glorieuses » n’étaient pas questionnés. Or, dans la France contemporaine, confrontée à une transition climatique et à une remise en cause de son modèle, ces choix ne vont plus de soi, et sont attaqués par les mouvements progressistes. Le fait d’aller dans les centres commerciaux, de rouler en SUV, de commander sur Amazon, tout ça devient politique”
Conséquence pour les marques de l’alimentaire : elles doivent désormais être extrêmement attentives à la connotation politique des produits qu’elles vendent. L’alimentation, longtemps un sujet consensuel et subjectif (“les goûts et les couleurs …”), devient aujourd’hui un terrain miné…
Les fractures alimentaires
L’Opinion a consacré un article fouillé sur ce qu’il appelle les “fractures alimentaires”, en étudiant la consommation de viande et de légumes.
En 2018, le Centre de recherche pour l'étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) montrait que la consommation de viande avait baissé de 12 % en France en dix ans. De manière contre-intuitive, l’étude montrait que la baisse était plus marquée … dans les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées : 113 grammes de viande par jour en moyenne chez les cadres (-19 %), 151 grammes chez les ouvriers (-15%).
“Dans les foyers les plus modestes, la viande est l’aliment qu’on garde même si le budget est serré, analyse Eric Birlouez, sociologue, spécialiste de la précarité alimentaire. On se prive pour que les enfants aient de la viande, qui est autant un carburant qu’un aliment de conquête sociale”
Pour Eric Birlouez, plus que la viande, ce sont les légumes qui sont devenus un enjeu. L’observatoire de Familles rurales (juillet 2021) montre que les cinq fruits et légumes par jour coûtent cher. Entre 117 et 222 euros par mois pour une famille avec deux enfants, soit 10 % à 18 % d’un smic net. Conséquence : le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) estimait en 2014 que les cadres consomment 50 % de fruits et 24 % de légumes de plus que les ouvriers.
Après la “fracture sociale” de 1995, et si les marques s’emparaient de la “fracture alimentaire” en 2022 ?
L’uniformisation de l’alimentation
Auteur d’une enquête remarquée sur les aliments menacés d’extinction (Eating to Extinction. The World’s Rarest Foods, and Why We Need to Save Them), le journaliste britannique Dan Saladino est revenu, dans un entretien au journal Le Monde, sur la tendance mondiale à l’uniformisation alimentaire :
“Sur les 6 000 à 7 000 plantes domestiquées par l’homme à travers l’histoire, nous en cultivons et consommons principalement neuf, parmi lesquelles trois fournissent plus de la moitié des calories mondiales : le blé, le riz et le maïs. Un même déclin s’observe parmi les races d’animaux d’élevage (…).
Dans l’Angleterre victorienne, on pouvait manger une pomme chaque jour pendant quatre ans, sans manger deux fois la même variété. Aujourd’hui, dans les supermarchés, on a le choix entre cinq ou six types de pommes”
Alors que nos sociétés modernes n’ont jamais semblé pouvoir nous donner accès à des aliments diversifiés, Dan Saladino montre que ce n’est qu’une illusion : “Oui, on a accès à un plus large panel d’aliments, mais c’est le même panel qui se déploie partout dans le monde, avec des produits très marketés et transformés”
L’agrobiodiversité, un nouvel axe de combat pour les marques ?
“Génération McDo”
Dans une note pour la Fondation Jean Jaurès, Jérome Fourquet analyse les rapports qu’entretiennent les 18-35 ans avec l’enseigne :
“Pourquoi les 18-35 ans ? Parce que c’est la première qui a grandi dans une France marquée significativement par l’empreinte de McDonald’s. En effet, pour les plus âgés d’entre eux, quand ils ont atteint l’âge de dix ans (en 1996), l’enseigne avait déjà considérablement étoffé son réseau puisqu’elle comptait à l’époque près de 500 restaurants. Depuis, toutes les classes d’âge suivantes se sont forgé leurs habitudes alimentaires et leurs références culturelles dans un environnement dans lequel l’enseigne n’a cessé de renforcer sa visibilité, donnant naissance à ce que nous pouvons appeler une « génération McDo »”
Plusieurs points forts se détachent de la note :
1/ En France, le maillage territorial de McDonald’s est exceptionnel. L’enseigne connu un essor spectaculaire depuis l’ouverture de son restaurant en 1979 : en 1986, la France ne comptait que 34 restaurants McDonald’s. Trente-cinq ans plus tard, l’enseigne en exploite plus de 1 607, faisant de la France le second marché au monde pour McDo, après les États-Unis. Aujourd’hui, tout le territoire est couvert.
2/ McDonald’s est l’une des rares marques fédératrices de l’Archipel français
McDo est fréquenté au moins une fois par mois par 51% des 18-35 ans (dont 22% plusieurs fois par mois) et 35% sont des consommateurs occasionnels (une fois ou quelques fois dans l’année). Seuls 14% de cette classe d’âge ne consomment jamais ou quasiment jamais McDo.
“McDonald’s fait donc partie de la vie de quasiment toute cette génération, qui compte 86% de clients de l’enseigne et dont la moitié peut même être qualifiée de consommateurs réguliers. Peu d’entreprises peuvent se targuer d’un tel taux de pénétration dans une classe d’âge !”
Le plus fort, c’est que le taux de consommateurs réguliers est quasiment identique dans tous les segments socio-démographiques de cette génération … et que la fréquentation de l’enseigne n’est pas clivée politiquement :
“On compte par exemple 57% de consommateurs réguliers parmi les sympathisants de La France insoumise et 52% auprès de ceux d’Europe Écologie-Les Verts, cette proportion étant équivalente parmi les soutiens de La République en marche (55%) ou du Rassemblement national (54%). McDo dispose donc d’une attractivité dans tous les milieux et fait partie du patrimoine générationnel commun des 18-35 ans”
3/ McDonald’s n’est pas qu’un restaurant : il est un lieu de sociabilité
L’enquête indique que McDo constitue un cadre souvent retenu pour vivre des événements marquants. Ainsi, 40% des 18-35 ans y ont déjà fêté un anniversaire (14% le leur, 26% celui d’un proche) ; 46% y ont célébré l’obtention de leur permis de conduire ; et même 20% des 18-35 ans se sont déjà rendu chez McDo à l’occasion d’une première sortie amoureuse !
“Le fait que McDo soit massivement fréquenté tient notamment au fait que l’on n’y vienne pas uniquement pour un repas. 49% des 18-35 ans (dont 11% souvent) vont également chez Ronnie seulement pour manger une glace, boire un verre ou un café. McDo fait donc aussi office de bistrot ou de salon de thé dans « la France d’après ».
4/ McDonald’s, l’un des principaux recruteurs de jeunes du pays
L’enseigne constitue également un pourvoyeur d’emplois ou de jobs étudiants ou d’été de premier ordre. 11% des 18-35 ans ont déjà travaillé chez McDo - c’est le cas à la fois des moins diplômés (16% parmi les sans diplôme et les titulaires d’un BEPC et 20% parmi les détenteurs d’un CAP ou BEP), mais aussi auprès des bacheliers et des diplômés du supérieur (10%).
Le “cas McDo” est un très bon exemple d’une marque qui a su développer des façons de se lier à son public qui dépassent son coeur de métier (la restauration rapide) : en devenant un lieu de célébration, de rencontres, d’expériences professionnelles …
MÉDIAS
Le baromètre de confiance dans les médias 2022
La Croix publie le 35e Baromètre de confiance dans les médias Kantar-Onepoint, qui livre plusieurs enseignements :
1/ Le pourcentage de Français qui suivent les nouvelles avec intérêt atteint le niveau le plus bas depuis 1987
En particulier, le décrochage des 18-24 ans est violent : ils ne sont que 38% à suivre les nouvelles avec grand intérêt (-13pts en un an)
Dans ce même baromètre, seuls 57% des Français ont le sentiment que les Français s’intéressent à l’actualité. On se souvient de ce chiffre donné par l’ObSoCo : post-pandémie, 7,8 millions de Français ont décidé de cesser de consulter l’actualité “pour se recentrer”. La tendance se confirme, et elle est inquiétante d’un point de vue démocratique …
2/ La télévision reste, de loin, le moyen par lequel le plus de Français s’informent sur l’actualité.
À noter, toutefois, qu’en termes de pratiques, l’écart générationnel se creuse entre les moins de 35 ans et le reste de la population : les moins de 35 ans s’informent majoritairement par internet (66%, loin devant la TV, à 25%), tandis que c’est l’inverse pour les plus de 35 ans (55% s’informent par la télévision, loin devant les réseaux sociaux à 20%).
Comment s’informent les antivax
“Ils ne regardent pas la télé, fuient les médias mainstream. Les « résistants » au passe préfèrent se renseigner sur internet, où ils ont leurs propres sites et leurs experts”.
Dans l’Obs, on lit une passionnante enquête sur la consommation média des antivax. À la question “comment vous informez-vous ?”, les réponses fusent : il y a les médias alternatifs (Sud Radio, TV Libertés), les médias étrangers (RT, la chaine d’info en continue financée par Moscou, ou encore VK, le réseau social russe), mais aussi une nébuleuse de sites spécialisés : Qactus, “service de réinformation gratuit”, Le Libre Penseur sur Twitch, La Croix du Sud sur Telegram, Les Moutons enragés, les sites Gettr, Rumble, CrowdBunker …
“C’est fou, le nombre de sites, réseaux sociaux et live, qu’on nous conseille !” s’exclame les journalistes Emmanuelle Anizon et Natacha Tatu :
“Les suivre, c’est entrer dans un monde parallèle, peuplé de compilations de “vidéos censurées”, de kyrielles d’experts, d’influenceurs, de superstars repris sans fin sur des sites qui se renvoient les uns aux autres pour former une espèce de toile dont il n’est pas si facile de sortir. Certains de ces sites semblent avoir été bricolés sur un coin de table, avec un contributeur unique et une orthographe approximative ; d’autres au contraire, très pros, ont adopté et détourné les codes des géants du secteur”
DIGITAL TRENDS
L’économie du faux avis sur Internet
À l’arrivée d’Internet, la possibilité donnée aux internautes de laisser leurs avis sur leurs achats laissait espérer « un retournement de l’équilibre des pouvoirs » face aux marques : on parlait souvent de faire parler la “sagesse de la foule” (the wisdom of the crowd). De fait, le pouvoir des avis sur internet n’a jamais été aussi important : en 2020, selon le sondeur Yougov, 72 % des internautes ont déjà renoncé à un achat après en avoir consulté.
En réalité, ce que raconte Le Monde, c’est qu’une véritable économie du faux avis s’est développée, laissant planer un gros doute sur la validité des notes et commentaires laissés un peu partout sur la toile :
“Sur Internet, les faussaires s’infiltrent dans les catalogues d’hôtels et de restaurants, dans les fiches des artisans et garages, dans les pages du moindre produit de consommation, des smartphones aux chaussures”
Au total, on estime que 20% des avis sont faux. Les marques ont industrialisé le processus, en ayant recourt à des agences de e-reputation qui créent par dizaines de milliers des faux comptes à même de rédiger des commentaires élogieux.
“Alterbuzz offre de « développer et entretenir des réseaux de fans et de “consommateurs-supporteurs” (…). En cas de crise, ils pourront s’exprimer en faveur de votre entreprise ou de votre marque”
Plus diabolique, un autre type de manoeuvre consiste à laisser des commentaires négatifs accompagnés d’une seule étoile pour torpiller les produits concurrents, “tel Samsung payant des étudiants taïwanais pour rabaisser son concurrent HTC en 2013, ou ce faussaire condamné en 2015 pour avoir publié la critique négative d’un restaurant cinq jours avant qu’il ouvre”. Qu’il soit positif ou négatif, le faux commentaire est facturé de 1 euro à 20 euros, selon le niveau de qualité.
“La manœuvre est particulièrement efficace, car les internautes font plus confiance aux avis négatifs, « surtout si le produit est cher et prestigieux, selon Daria Plotkina. Ils ont l’habitude de regarder le pire scénario possible. Même un petit nombre d’avis négatifs peut détruire l’intention d’acheter ». Et comme les avis négatifs sont beaucoup plus rares que les commentaires positifs, il suffit d’en publier un faible volume pour disqualifier un concurrent.
Pour peaufiner la tromperie, on peut fabriquer de toutes pièces un faux défaut, et le mentionner dans deux ou trois avis différents, publiés via plusieurs faux comptes, en prenant garde à le reformuler”
“GIFs Are For Boomers Now, Sorry”
C’est la conclusion à laquelle est arrivé le magazine américain Vice, dans un article qui a fait grand bruit. Né en 1987, le gif, si populaire et omniprésent dans nos différentes messageries, serait devenu ringard (“uncool”) … mais c’est précisément sa popularité, ou sa trop grande démocratisation, qui a causé sa parte.
“Pendant des années, écrit Le Monde, le gif était un secret partagé par ce qui était finalement un petit groupe d’utilisateurs. Puis, Google a créé un filtre spécial en 2013 pour les chercher. Des bases de données de gifs sont également apparues, rendant le travail de recherche plus simple. C’est d’ailleurs en 2013 qu’est née Giphy, la plus célèbre de toutes” - que Facebook a d’ailleurs rachetée en 2020 pour … 400 millions de dollars.
“That democratisation creates a sense of disgust with people who consider themselves insiders”, explique Whitney Phillips, professeur de communication à Syracuse University et spécialiste de la culture internet.
“The more GIFs there are, maybe the less they’re regarded as being special treasures or gifts that you’re giving people (…). Rather than looking far and wide to find a GIF to send you, it’s clicking the search button and typing a word. The gift economy around GIFs has shifted.”
Vice souligne par ailleurs que de nombreux papas, de nombreuses mamans, ainsi que des grands-parents ont, eux aussi, découvert les joies du partage de gifs lors des confinements : en avril 2020, Giphy avait d’ailleurs annoncé une hausse de 33 % de l’utilisation des gifs par rapport au mois précédent.
Résultat : la coolness s’est déportée sur les mèmes. « Avec montée en popularité des mèmes [des objets culturels repris et détournés] et d’Instagram, les gifs sont devenus plus rares et sont passés de mode »
Autre explication : l’uniformisation des gifs, dont le nombre qui franchit le mur du son sur les différentes plateformes (Facebook, WhatsApp, Twitter, Spotify, Tinder) est extrêmement limité. Grosso modo, le résultat des recherches fait tout le temps ressortir les six ou sept mêmes gifs :
“I think the issue with GIFs is that you often tend to see people using the same ones to express a certain sentiment – the ‘blinking/double take’ guy for surprise or the Leonardo DiCaprio raising a glass for celebration – maybe people are becoming fatigued from over-use of certain ones.”
Lu dans le Canard enchainé du 26 janvier 2022 :
Apple : la petite bulle bleue d’iMessage, signe de distinction chez les ados
Il n’y a pas si longtemps, ce sont les fringues qui jouaient le rôle de distinction sociale entre les ados : aujourd’hui, il semblerait que le marqueur soit passé à la téléphonie.
“Bulle bleue” contre “bulle verte” : The Wall Street Journal raconte que chez les adolescents américains, la différenciation de couleur est devenue un symbole de statut social, voire même un motif de discrimination envers les “green texters”
L’article souligne la stratégie de fidélisation d’Apple, qui en serait en grande partie responsable. Technologiquement, cela passe par la création de fonctions exclusives aux utilisateurs d’Apple (bulle bleue, mais aussi la création de groupes de discussions à plusieurs ou l’utilisation de memojis, ces emojis Apple que l’on peut animer avec son propre visage) qui, de facto, excluent les utilisateurs Androïd.
Le énième avatar de rivalités de marques concurrentes (McDo vs Burger King, Pepsi vs Coca-Cola), ou les limites des stratégies de fidélisation ?
LA PROXIMITÉ A DE L’AVENIR
Le patron d’Uber veut devenir le “leader mondial du commerce local”
Avec la pandémie, Uber a accéléré son changement de modèle pour devenir un expert de la livraison. Son patron, Dara Khosrowshahi, a accordé un entretien dans L’Express, dans lequel il annonce un ahurissant pivot de son business model, déclarant vouloir concurrencer Amazon (!) :
“C'est la technologie qui va permettre au commerçant local de dépasser Amazon. Avec des services comme le nôtre, le commerçant local dans votre ville sera en mesure de livrer plus rapidement qu'Amazon ne le pourra jamais. Nous voulons accompagner le développement des entreprises de quartier, qui dans le passé n'ont pas profité de toute la puissance des nouvelles technologies des plateformes. Amazon est le leader du commerce électronique dans le monde. Nous pensons pouvoir être le leader du commerce local”
Revenant sur le développement de Uber, il explique que, partant d’une entreprise de transport, la marque a développé une activité de livraison, commercialement plus importante que son activité de transport. Uber est en train de construire une activité de fret et un écosystème logistique qui peut devenir sa principale activité :
“Ce qui m'a le plus surpris chez Uber, c'est que de toutes les entreprises technologiques, elle est la plus locale. Nous ne construisons pas de la technologie pour le cloud ou pour une vie numérique. Nous construisons de la technologie pour votre vie réelle. Vous appuyez sur un bouton, et une voiture apparaît, ou on vous livre vos courses”
La livraison en 10 minutes : l’essor du “business de la flemme”
Gorillas, Blink, Dija, Cajoo, Picnic … en peu de temps, une vingtaine de start-ups se sont positionnées sur le “quick commerce”, le marché de la livraison de courses à domicile qui promet de livrer en 15 voire 10 minutes. Si le marché est florissant, c’est qu’il repose en grande partie … sur la flemme du consommateur. "Nous démocratisons le droit à la paresse", affirme même au Guardian le directeur général de Getir UK.
Pour y parvenir, leur modèle est bien rodé, explique Novethic :
“Il s’agit, pour ne pas perdre une seconde, d’installer des dark stores, des mini-entrepôts, en plein cœur des villes, où les commandes sont assemblées et d’où partent les livraisons. Plus le maillage de dark stores est important, plus les enseignes sont à même de proposer des délais de livraisons ultra-rapides"
Mais ces magasins-entrepôts sont accusés de défigurer les villes et de remplacer les commerces de proximité : dans Le Figaro, on lit que les villes de Paris, Lyon, Lille et Bordeaux avaient décidé de “déclarer la guerre aux dark stores”, trouvant des voies légales (souvent via le plan local d’urbanisme) pour limiter leur développement.
Ce qui est intéressant, c’est que deux modèles de proximité semblent s’affronter, l’un orienté client et l’autre orienté Cité.
Remarque de Brigitte Baronnet, journaliste AlloCiné, en comparant plusieurs affiches de films récentes : “la consolation s’affiche”. Bien vu : cela se matérialise aussi comme ça, le besoin de proximité
LES MARQUES EN CAMPAGNE 🇫🇷
Pouvoir d’achat : Leclerc veut être un “rempart contre l’inflation”
Alors que la poussée inflationniste commence à se faire sur les produits alimentaires (+40% sur les pâtes premiers prix en quelques semaines), et que le pouvoir d’achat s’invite dans la campagne électorale, Michel-Edouard Leclerc annonce qu’il bloquait pendant 4 mois le prix de la baguette de pain à 29 centimes, pour « défendre le pouvoir d’achat des Français » - provoquant illico la colère des boulangers, l’accusant de concurrence déloyale, et des agriculteurs, pestant contre la destruction de la valeur à l’échelle de l’écosystème tout entier.
Il fallait écouter l’intervention de MEL sur LCI, le 27 janvier, pour réaliser le poids qu’entendait jouer la grande distribution dans la période :
“Cette période va démontrer l’utilité sociétale de nos métiers. En jouant sur nos marges, en bloquant le prix d’un certain nombre de produits-marqueurs (les baguettes, mais aussi les masques, l’essence, les kits d’hygiène féminine, les repas étudiants), on veut être utile au pays, et donner des repères aux gens”
MEL, ministre de l’Économie-bis d’une économie planifiée ?
Violences faites aux femmes : Camaïeu promeut le 3919
Camaïeu a décidé de réaliser une campagne complète pour promouvoir le numéro 3919 - numéro national de référence d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de toutes formes de violences :
“Sur notre site, vous pouvez découvrir depuis quelques semaines le 3919 qui remplace le prix de certains produits. Un détournement opéré dans le but de faire connaître ce numéro auprès de toutes les femmes qui ne le connaissent pas encore.
L'opération spéciale sur notre site incriminée fait partie d'un programme complet mis en place depuis début janvier : numéro visible dans tous les magasins Camaieu, en cabines et sur nos tickets de caisse, un t-shirt 3919 porté par les 2300 collaboratrices de notre réseau, un don solidaire proposé en caisse au profit de l'association SOLFA”
Frappant de constater que ce soit une marque (et non un(e) candidat(e) à la présidentielle) qui parvienne à mettre le sujet des violences faites aux femmes dans le débat public …
Pascal Demurger (MAIF) propose ses pistes pour réinventer le rapport Etat/entreprises et construire une “prospérité durable”
“À l’État de fixer l’ambition et aux entreprises de mettre en œuvre les solutions. Tel est, pour demain, l’enjeu d’un nouveau contrat entre celles-ci et celui-là d’un pacte commun pour un impact massif”. Dans un rapport de 20 pages publié par la Fondation Jean Jaurès, le patron de la MAIF propose des mesures pour “inciter, sans contraindre, chaque entreprise à se mettre au service d’un projet de société supérieur, démocratiquement défini”:
1/ Distinguer les acteurs économiques selon leur comportement.
Demurger propose que l’impôt sur les sociétés soit modulé, avec des taux différenciés, à échelle des efforts faits par les entreprises en matière environnementale.
Il souhaite également reconsidérer l’accès aux aides publiques et aux marchés publics, “en mettant sur un pied d’égalité critères environnementaux et critères économiques” - le tout, dans une logique de “prime à la vertu et à la responsabilité collective”
2/ Un “impact score” global, pour réévaluer leur performance à partir de critères autant extra-financiers que financiers
Pascal Demurger va jusqu’à proposer un grand “Ministère de la Transition écologique et de l’Économie”. À date, c’est peut-être un patron qui a proposé le programme d’économie responsable le plus abouti pour la présidentielle !
NEW DEAL
Dans sa lettre annuelle, le patron de BlackRock vante les “pouvoirs du capitalisme” pour relever les futurs défis de l’entreprise
Tous les ans, Larry Fink adresse à ses différentes parties prenantes une lettre ouverte, qui a pour fonction de dresser les priorités de son fonds d’investissement pour l’année à venir. Le cru 2022 distingue trois grandes orientations ;
1/ La voix des CEO est plus attendue que jamais dans le débat public
“It’s never been more essential for CEOs to have a consistent voice, a clear purpose, a coherent strategy, and a long-term view. Your company’s purpose is its north star in this tumultuous environment (…). They don’t want to hear us, as CEOs, opine on every issue of the day, but they do need to know where we stand on the societal issues intrinsic to our companies’
2/ À l’ère du télétravail, les entreprises doivent écouter les nouveaux besoins de ses salariés : c’est un vrai levier de leadership
“Workers demanding more from their employers is an essential feature of effective capitalism. It drives prosperity and creates a more competitive landscape for talent, pushing companies to create better, more innovative environments for their employees – actions that will help them achieve greater profits for their shareholders. Companies that deliver are reaping the rewards”
3/ La transition écologique est une nouvelle donne du capitalisme
“Every company and every industry will be transformed by the transition to a net zero world. The question is, will you lead, or will you be led?”
"We focus on sustainability not because we’re environmentalists, but because we are capitalists."
Le verdissement de l’économie, nouvel angle d’attaque des fonds activistes
En 2021, plus de 300 entreprises européennes ont été prises à parti par des fonds activistes - c’est-à-dire, par des actionnaires minoritaires qui cherchent à imposer des changements de stratégie ou de gouvernance pour doper les cours de leur cible.
Les Echos note une évolution de leur requête : il ne s’agit plus seulement de militer pour la nomination de nouveaux membres au conseil d’administration, ou pour des changements de direction (ex: Danone), mais de pratiquer un activisme … environnemental :
“Cette année, les questions ESG (environnementales, sociales et de gourmande) pourraient devenir leur nouveau cheval de bataille. 80% des activistes interrogés sont convaincus que ces sujets deviendront prioritaire”
Ces derniers temps, plusieurs exemples ont marqué les esprits. Le britannique TCI, premier fonds activiste européen, a poussé au dépôt de résolutions climat lors des assemblées générales. Fin 2021, le fonds Enkraft s’est attaqué à RWE, le premier producteur d’électricité d’Allemagne, pour rehausser ses ambitions climatiques.
Point important : en 2022, les fonds devraient bénéficier d’une force de frappe plus importante que par le passé
“Pendant longtemps, les investisseurs institutionnels ont hésité à soutenir les activistes. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il existe de vraies alliances entre ces deux types d’actionnaires. Les institutionnels laissent les activistes faire le boulot mais ils les soutiennent de plus en plus fréquemment. Pour les sociétés, cela risque de devenir plus compliqué dans le futur : autant ils pouvaient diaboliser les activistes en les accusant notamment de court-termisme, autant ils ne peuvent pas ignorer les demandes des actionnaires institutionnels”
Trois leviers pour sortir du conflit consommateur-citoyen
Pour l’excellent blog Hub de la Poste, Philippe Moati, cofondateur de l’Observatoire Société et Consommation, revient sur la notion de “paradoxe” de la consommation responsable :
“Nos comportements de consommation sont le fruit d’un compromis entre nos idéaux et nos contraintes. Nos idéaux, c’est là où nous voulons aller en fonction de nos valeurs, de nos buts dans la vie, des normes sociales, etc. Et les contraintes, c’est ce qui s’impose à nous, et qui peut nous empêcher d’atteindre nos idéaux. Cela explique qu’une même personne déclare certaines choses dans une enquête, mais agit différemment”
D’où un conflit inévitable entre citoyen et consommateur. Philippe Moati développe un levier essentiel pour en sortir : le changement culturel.
“Un changement des normes et des valeurs qui remette la consommation à sa place. La place qu’a prise la consommation dans notre société est liée au recul de ce qui donnait du sens à nos vies. Recul des idéologies, de la religion, des croyances… La consommation a rempli le vide existentiel. Consommer a donné du sens à notre existence. Pour faire reculer la consommation, il faut donc remplir ce vide par autre chose, qui épanouisse l’individu.
Et de souligner que, dans les études qu’il a menées, plus le citoyen est engagé dans du “faire” (la cuisine, du bricolage, de la couture …) et plus il est à même d’avoir une consommation génératrice de bien être.
“Les marques peuvent accompagner les gens dans cette voie. Quand on commence ce genre d’activités, on manque de savoir-faire. On n’est pas content du résultat et on abandonne. Les marques ont un rôle à jouer pour accompagner ceux qui débutent et les faire monter en compétences, comme le fait Leroy Merlin pour les bricoleurs ou Decathlon pour les sportifs”
DERNIÈRES PARUTIONS
Un livre : “Le prix de nos valeurs” (Augustin Landier & David Thesmar, Flammarion, 2021)
Combien sommes-nous prêts à payer en plus pour que notre voiture soit produire localement, ou pour que notre alimentation soit plus saine ? C’est à ce type de question que tentent de répondre les économistes Augustin Landier et David Thesmar, dans leur dernier essai.
Tou deux défendent une meilleure prise en compte des valeurs (la liberté, l’identité, l’égalité, la justice, etc.) dans les modèles économiques. Selon eux, les individus arbitrent en permanence entre leur intérêt personnel et leur système de valeurs - que ce soit dans leurs choix de consommation, d’emploi ou de lieux de vie : c’est ce qu’ils appellent les « préférences économico-morales ». Avec ce modèle, la science économique s’adapte à la nouvelle ère : celle des valeurs.
Résultats : nous sommes globalement prêts à payer plus chers un produit/un service pour défendre des valeurs. Toute la subtilité de ce livre est d’évaluer précisément combien, dans quelle situation, pour quel type de produits, etc. Les auteurs structurent la diversité des réponses autour de deux axes : droite/gauche et individualisme/collectivisme. Passionnant !
Une série-documentaire : Émoji-nation (Arte)
Selon le consortium Unicode, 92% des internautes dans le monde agrémentent régulièrement leurs messages d’émojis en tout genre. Ces petits pictogrammes colorés, créés à la fin des années 1990 au Japon, envahissent désormais nos SMS et (presque) toutes nos conversations en ligne. On en dénombre aujourd’hui plus de 3 600. Arte.tv y consacre une mini-série documentaire, ludique et interactive, intitulée Emoji-Nation. On y apprend que les planches des premiers émojis dessinés par Shigetaka Kurita sont conservées au MoMA à New York. On y ravive le souvenir d’une Assemblée de Corse qui aurait dépensé 52 800 euros pour promouvoir son émoji « drapeau à tête de Maure ».
Véritable révolution en matière de communication (digitale), les émojis : « sont devenus une forme courante d’alphabet pictural. Les mouvements artistiques comme la bande dessinée, le futurisme ou le dadaïsme ont tous contribué à remodeler notre cerveau moderne pour l’amener à visualiser le sens, pour l’amener à s’exprimer au moyen d’une image plutôt qu’à travers un texte linéaire » dixit Marcel Danesi, professeur de sémiotique et d'anthropologie linguistique à l'Université de Toronto.
Emoji-Nation offre une diversité de points de vue et apporte un éclairage des plus passionnants sur l’essor des émojis et sur l’usage que nous en faisons. Mais la série, notamment dans les deux derniers épisodes, concentre sa réflexion sur les liens étroits entre le consortium Unicode, qui supervise la création, le codage ainsi que le lancement de nouveaux émojis, et les géants du numérique. Adobe, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix figurent effectivement parmi ses adhérents. Quel rôle ces multinationales jouent-elles dans la validation des émojis et dans le contrôle de la représentation de nos émotions ? Entre inquiétude et amusement, Stéphanie Cabre, la journaliste à l’origine de la série, s’interroge : « En plus d’une décennie, l’armada des émojis s’est bien installée dans nos téléphones alors que les maîtres du monde digital structurent nos vies numériques. Je me demande si cette gestion centralisée de la sémantique de nos claviers ne cache pas quelque chose. Les émojis permettraient-ils aux géants du Web de modifier nos comportements linguistiques et donc de mieux nous contrôler ?».
Top 10 des émojis les plus utilisés dans le monde en 2021
😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊
Les émojis les plus populaires par catégorie
👑 (vêtements, accessoires), 🚀 (transport, air), 💪 (partie du corps), 💐 (plante, fleur), 🦋 (animal), 🎂 (alimentation sucrée), 🎉(événement)
Une exposition : “Le design pour tous : de Prisunic à Monoprix, une aventure française” (Musée des Arts Décoratifs)
Le grand public l’a oublié, mais Prisunic (racheté par Monoprix en 1997) a longtemps été un “IKEA à la française”, cherchant à démocratiser le mobilier et l’habillement contemporains de qualité. « Le beau au prix du laid » devient le slogan initié par Denise Fayolle, directrice du bureau de style de Prisunic de 1957 à 1967.
C’est cette formidable aventure, commerciale et esthétique, que retrace l’exposition du Musée des Arts Décoratifs.
“L’exposition, thématique et chronologique, est conçue en deux parties : la première, consacrée à Prisunic, s’illustre par des collaborations majeures initiées avec des graphistes et designers que les catalogues de vente par correspondance diffusent entre 1968 et 1976. Le second volet met en lumière les réalisations phares de créateurs invités par Monoprix en reprenant un thème cher à l’enseigne – l’objet du quotidien – à travers l’art de la table, l’assise et l’habillement”
A voir !
C’est tout pour aujourd’hui ! Rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro de la CORTEX NEWSLETTER.